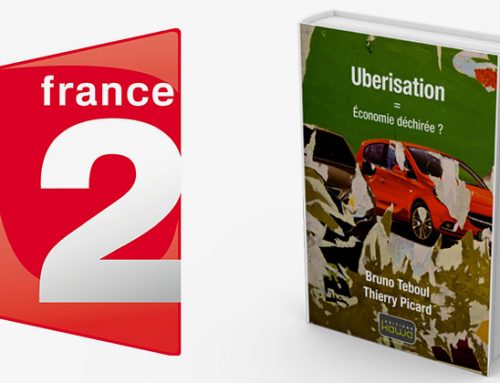>>> Article paru dans Marianne daté du 5 juin
>>> Article paru dans Marianne daté du 5 juin
Le 16 avril dernier, l’improbable est arrivé. François Hollande, lors d’un voyage officiel en Suisse, concédait publiquement avoir cédé, lui aussi, aux sirènes de l’illimité. Pour la bonne cause, pas pour promouvoir la dernière initiative bancale destinée à ruiner le téléchargement illégal, mais pour défendre l’emploi et la formation. « OpenClassrooms est leader en Europe dans le secteur des Mooc [cours en ligne], a-t-il fermement déclaré. Une idée m’est venue, que cette opportunité soit accessible aussi à ceux qui en ont le plus besoin. Et qui en a le plus besoin ? Ceux qui sont en recherche d’emploi. » Aussi, à partir de septembre 2015, le premier fonctionnaire de France a-t-il décrété que les demandeurs d’emploi auront un accès gratuit et illimité à tous les services numériques de la plate-forme française d’e-éducation, afin de télécharger e-books, vidéos et cours certifiants.
Phénomène mondial
Voilà qui risque d’alimenter les débats sur la fracture numérique, mais, surtout, qui contraste étrangement avec la crispation gouvernementale observée lorsque l’ex-frondeur Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif, confirmait l’ouverture à Chalon-sur-Saône, en septembre 2012, du troisième entrepôt d’Amazon, le leader mondial tant décrié de la distribution en ligne. Sa consœur à la Culture, Aurélie Filippetti, s’était emportée : « Tout le monde en a assez d’Amazon et de son dumping social. » Une position qui aboutira, en 2014, à une loi visant directement le géant américain et fixant les conditions de vente du livre à distance. Une loi que le sociologue Vincent Chabault* craignait d’être inopérante à « freiner les mutations du commerce en ligne ». A raison. « La consommation en ligne est un phénomène mondial, avait déclaré Arnaud Montebourg, à l’époque. Il ne faut pas l’opposer à la librairie indépendante, les deux doivent cohabiter. » Ses paroles viennent de trouver une curieuse résonance, alors que la guerre des tranchées qui oppose Amazon, dont la devise affichée est « Work hard, have fun and make history » (« Travaillez dur, amusez-vous et entrez dans l’histoire »), et la citadelle assiégée de l’édition et des libraires n’en finit plus de faire couler l’encre.
L’ILLIMITÉ EST LA DERNIÈRE TROUVAILLE MARKETING À FAIRE TOURNER LE MONDE, RÉEL ET NUMÉRIQUE, AMORCÉE DANS LES ANNÉES 80
Marchandisation globale
En effet, la firme de Jeff Bezos a relancé les hostilités, en proposant, en décembre dernier en France, après l’Allemagne, l’Italie et l’Espagne, son Kindle Unlimited, une liseuse permettant d’accéder, moyennant 9,99 € mensuels, à 700 000 livres numériques, dont 20 000 références en français, et plus de 2 000 livres audio. Une bonne partie de ce catalogue provient directement de la plate-forme d’autoédition Kindle Direct Publishing, mais Amazon promet qu’on y trouvera aussi l’intégralité de la saga du magicien binoclard Harry Potter et le classique de George Orwell, la Ferme des animaux. Un peu limité pour de l’illimité. Surtout pour les auteurs, qui ne seront pas rémunérés automatiquement à chaque emprunt. « Il y a un grand flou sur cette question », explique Vincent Monadé, président du Centre national du livre (CNL). C’est le moins qu’on puisse dire. Pour que l’auteur touche ses droits, il faudra en effet que le lecteur ait parcouru au moins 10 % de son livre… Qu’importe. L’illimité est la dernière trouvaille marketing à faire tourner le monde, réel et numérique. Amorcée dans les années 80, avec l’américaine CNN, qui fut la première chaîne télé au monde à proposer de l’information en continu et en illimité, et avec sa petite sœur MTV, qui fut, elle, le premier robinet à clips de l’industrie musicale, la tentation de l’illimité a envahi tous les champs de la consommation, des transports en commun aux jeux vidéo en passant par les télécoms, les parcs d’attractions et les cabinets d’esthétique. Et par la culture, bien sûr, à la faveur des nouvelles technologies et de la dématérialisation des supports, qui amorce un nouveau consumérisme dépassant toutes les bornes. Tout cela valide la sentence du prophétique essayiste Guy Debord qui, dans la Société du spectacle, annonçait dès la fin des années 60 : « La culture, devenue intégralement marchandise, doit aussi devenir la marchandise vedette de la société spectaculaire. » Faisant craindre, aujourd’hui, au philosophe Bernard Stiegler sa « destruction. »
Le 7e art fut le premier à entrer dans le cercle de la « marchandisation » ad nauseam, grâce au groupe européen d’exploitation cinématographique UGC, qui, il y a quinze ans, offrait, séance tenante, accès à toutes ses salles contre un abonnement mensuel de 20 €. Jusqu’à risquer l’abcès de la cornée. Tollé général. Le solidaire milieu du cinéma était alors monté au créneau, en criant à la mort de la création. Quinze ans plus tard, 15 millions d’entrées sont vendues en « formule illimitée » chaque année, soit une sur 10 ; les multiplexes ont bien eu la peau des cinémas de quartier, mais la création cinématographique, elle, n’a pas trépassé. En 2014, elle a même dopé la fréquentation des salles (200 millions d’entrées, soit 7,7 % d’augmentation par rapport à 2013).
« Streming ad nauseam »
Le monde de la musique essuya, lui, les bits de la révolution numérique. En ratant le virage 2.0 de la société et en s’accrochant à tout ce qui avait fait historiquement son succès, à savoir les ventes physiques de vinyles et, plus tard, de CD, il est en état de coma dépassé. «
APPLE ET AMAZON NE SONT QUE DES MACHINES DE DESTRUCTION DE VALEURS CULTURELLES. CE BUSINESS MODEL TUE LA CRÉATION » ALEXANDRE SAP
Au bord de la faillite depuis dix ans, l’industrie musicale ne doit son salut qu’au numérique (46 % des ventes) et aux services de streaming par abonnement (+ 39 % en 2014). Même Pascal Nègre, le très médiatique PDG d’Universal Music France, le groupe mondial qui produit 40 % de la musique du globe, a dû satisfaire à cette exigence. Les plates-formes de streamingmusical comme la suédoise Spotify et ses 15 millions d’abonnés ou la française Deezer et ses 6 millions de connectés alimentent en continu, pour moins de 10 € par mois, les oreilles de 78 % des internautes français. « Après la piraterie, les sonneries téléphoniques et le modèle iTunes, confesse-t-il à présent, la musique change à nouveau de paradigme avec l’avènement du streaming, qui consiste à payer pour un usage et non pour une possession. » Jusqu’à en avoir des acouphènes. Même le producteur vedette américain Jay-Z vient de sortir la sienne, Tidal, où l’internaute mélomane peut s’abreuver de 25 millions de titres en qualité CD et de 75 000 vidéos haute définition pour 19,99 € par mois et 9,99 € pour une qualité standard. Un flop, car ses actionnaires ne sont autres que Madonna, Beyoncé, Daft Punk, Rihanna, Kanye West, Usher… Peu importe la fausse note des nantis de la musique, jouant la gamme de l’illimité pour engranger plus de royalties, la partition semble écrite d’avance. Au moment où le Midem vient d’ouvrir ses portes à Cannes, Apple, à la suite du rachat pour 3 milliards de dollars de Beats Music, la juteuse entreprise du producteur de rap Dr Dre, se prépare, pour rattraper son retard, à annoncer le lancement de son propre service de streaming, directement accessible, pour 7,99 dollars mensuels, aux millions de propriétaires d’iPhone. Autant dire que la guerre de l’illimité dans la musique en ligne ne fait que commencer et que l’addiction n’est pas près de s’arrêter pour le consommateur avide. Quitte à ne plus savoir ce qu’il ingurgite, enivré, seulement de cette surmultiplication des données. « Apple et Amazon, ces majors de la distribution, s’insurge Alexandre Sap, ancien directeur de label indépendant et patron de Forward (lire l’encadré), ne sont que des machines de destruction de valeurs culturelles. Face à elles, la musique, le cinéma et l’édition peinent à préserver leurs catalogues. Ce business model tue la création et rend ceux qui en sont dépendants totalement acculturés. » Certains artistes résistent pour cela au streaming, comme Cabrel ou Goldmann. Mais, dès lors, ils sont moins écoutés.
Addiction destructrice
Acculturés, les 60 millions d’abonnés (500 000 en France) de la plate-forme américaine de streamingNetflix ? Peut-être, mais accro au tout, tout de suite, sûrement. Car Netflix bouleverse toutes les règles. Pour 7,99 € par mois, l’abonné peut ingurgiter, comme il le souhaite et quand il le souhaite, films et séries. Jusqu’à l’overdose : c’est le binge watching. Un autre dealer d’images, illégal cette fois, Popcorn Time, le talonne à présent sur ce marché. Qualifié de « pire cauchemar de Hollywood », il offre à l’infini des films et des séries récentes en qualité haute définition. Jusqu’à l’indigestion. Sur leur blog, ses créateurs s’en expliquent : « Le piratage n’est pas un problème de personnes. C’est un problème de service. Un problème créé par une industrie qui considère l’innovation comme une menace pour leur modèle économique antique. » Fermez le ban !
Dernière des industries culturelles à être touchées par la pandémie de l’illimité, l’édition. Et de quelle façon ! Des offres existaient déjà, lekiosk.com, pour la presse, publie.net, youboox.fr, youscribe.com pour le livre ou izneo.com pour la BD, mais le choc frontal de Kindle Unlimited, la librairie numérique d’Amazon, dans un contexte de récession, affole éditeurs et libraires. Les résultats d’une enquête Ipsos-CNL, opportunément sortie lors du dernier Salon du livre, en mars dernier, sont édifiants. Le pays aux 15 prix Nobel de littérature lit de moins en moins : seulement un livre par an pour 90 % des Français. Le temps de lecture moyen hebdomadaire a aussi diminué de vingt-huit minutes depuis trois ans. Et la fracture générationnelle est béante. Les 15-24 ans confessent à 45 % consacrer plus de temps à surfer sur Internet, à écouter de la musique ou à alimenter les réseaux sociaux qu’à lire. Au point que Vincent Monadé veut déclarer « la lecture grande cause nationale ». Devant la stratégie d’Amazon, l’édition a donc, comme le cinéma, la musique et la télévision avant elle, saisi, au nom de la destruction du marché du livre, le ministère de la Culture. Fleur Pellerin s’est empressée de déclarer « illégale » l’offre illimitée et a enjoint aux frondeurs de s’aligner sur la loi française sous trois mois, suivant ainsi l’avis de la médiatrice, Laurence Engel, ex-directrice de cabinet de l’ancienne ministre de la Culture Aurélie Filippetti. Elle rappelle que seuls les éditeurs doivent pouvoir fixer le prix du livre numérique. Un prix qui, depuis 2011, est aligné sur celui du livre papier, un prix unique régi par la loi Lang de 1981. « De ce point de vue, les abonnements forfaitaires illimités qui concerneraient plusieurs éditeurs ne respectent pas la loi », a-t-elle tranché. Le Netflix du livre, qui s’est enfin décidé à payer des impôts en France, a, lui, déjà botté en touche. Il se présente comme une bibliothèque privée virtuelle et non comme un service de location, l’utilisateur n’achetant pas une copie mais un droit d’accès, exactement comme le permet tout abonnement à n’importe quelle bibliothèque municipale.
POUR CONTOURNER LA LOI, AMAZON SE PRÉSENTE COMME UNE BIBLIOTHÈQUE PRIVÉE VIRTUELLE, FAISANT PAYER UN SIMPLE DROIT D’ACCÈS
L’illimité… et après ?
Mais, au pays de l’exception culturelle, les éditeurs font de la résistance. « Le vrai problème d’Amazon, analyse-t-on à Actes Sud, ce sont les droits d’auteur. Ils sont bafoués. Nous nous battrons, le rouleau compresseur ne nous écrasera pas aussi facilement. » Dont acte. Comme aux Etats-Unis, où les big five du secteur (HarperCollins, Hachette Book Group, Simon & Schuster, Penguin Random House et Macmillan) font la sourde oreille à toute proposition, aucune major française du livre ne répond à l’appel d’Amazon. « Je serai le dernier à plonger. Ça n’a aucun sens, vraiment aucun sens, a assené Arnaud Nourry, PDG du groupe Hachette Livre, sur BFM. Si nous allions vers les abonnements, nous irions vers la destruction du modèle économique que nous mettons en place. » Alain Kouck, PDG d’Editis, qui regroupe 40 marques d’édition et n’a signé avec aucune plate-forme déjà existante, semble peu enclin à traiter avec la firme de Seattle. Quant à Immatériel, le distributeur qui regroupe près de 600 éditeurs, il a émis une fin de non-recevoir. Tant pis pour les potentiels nouveaux lecteurs que pourrait apporter ce nouveau « média » vorace. Car, aux Etats-Unis, l’illimité, ce « gavage qui résulte de la marchandisation de la culture », comme le définit l’écrivain Annie Le Brun, semble booster, au moins à court terme, les ventes de livres. Selon le dernier rapport Nielsen Book, les abonnés à des formules comme Kindle Unlimited ou Oyster dépenseraient pour satisfaire leur addiction plus que les autres consommateurs américains : 58 dollars, contre 34. Mais peut-être plus pour très longtemps…
« L’avenir sans fin s’ouvre à l’être illimité », affirmait Victor Hugo dans ses Odes. Sans fin ? Pas pour les abonnements illimités en tout cas, qui pourraient prochainement disparaître aux Etats-Unis sous les attaques de l’agressif Gafa, l’entité très réelle composée par les géants de ce qu’on appelle outre-Atlantique le soft power du virtuel régentant de plus en plus l’existence toxicomane des individus, les Google, Apple, Facebook et Amazon. Car, une fois le seuil de la consommation de données en « illimité » dépassé, l’internaute devra s’acquitter d’un supplément. Le Gafa amorce ainsi l’idée d’un Internet à plusieurs vitesses.
En attendant, Amazon continue d’alimenter la vie du consommateur. La firme vient de lancer le « Dash Button », un boîtier connecté au WiFi, via l’application Amazon pour smartphone, qui permet, de chez soi, de passer commande de produits du quotidien par le simple effleurement d’un « bouton ». Demain, aussi pour les produits culturels ? Définitivement sans limites… mercantiles.
Alexandre Sap n’y va pas par quatre chemins : face aux attaques du Gafa (Google, Apple, Facebook, Amazon), l’avant-garde serait le seul salut des entreprises culturelles. Cet ancien créateur et directeur du label indépendant Recall Group, qui a signé en 2005 le premier contrat français de distribution avec iTunes et qui est, depuis, à la tête de Forward, une entreprise spécialisée dans le marketing culturel, défend l’urgence d’une réappropriation de la culture par ses acteurs. « Défendons nos droits, reprenons le contrôle de nos intérêts, remettons l’humain au centre de cette machine infernale, s’enflamme-t-il. Les Apple, Amazon et Spotify ne créent rien, ils se contentent de se nourrir sur la bête. Mais elle va se relever. C’est à nous de combattre ces géants. » Dans Rebirth Of The Cool, son dernier livre, Alexandre Sap, en donnant la parole à des créateurs (le graffeur André Saraiva, le fondateur de Purple Magazine Olivier Zahm, le photographe Francesco Carrozzini…) et des acteurs de la société culturelle (le conservateur de musée Jérôme Sans, le fondateur du label Roc Nation John Meneilly, le cofondateur des Inrockuptibles Jean-Daniel Beauvallet…) s’interroge sur une culture bradée et sur les moyens de la faire à nouveau émerger. « Pendant qu’on se battait contre le piratage, explique-t-il, on n’a pas vu arriver le danger du format propriétaire. La Silicon Valley rafle le travail des créateurs, avec le seul but d’alimenter les ventes de son matériel propre, Kindle, iPhone ou iWatch. » Alors ? « Alors, prenons à nouveau des risques, créons et libérons-nous de ces contraintes imposées ! » Chiche.
Rebirth Of The Cool, d’Alexandre Sap, Kawa, 153 p., 19,95 €.
Source : Marianne